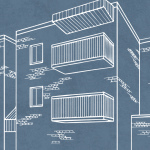« J’ai grandi avec un gros tipi au cœur de mon village. Mais notre culture, c’est les maisons longues. » Isabelle Picard a passé ses 13 premières années de vie au milieu des membres de sa Nation huronne-wendat de Wendake, et pourtant coupée de sa culture. Une culture déjà très altérée à cette époque par la Loi sur les Indiens. De ses conséquences, on connaît les pensionnats, les femmes disparues, mais moins la rafle des années 60 qui a permis le placement forcé de milliers d’enfants, déchiré autant de familles, et participé à l’acculturation des communautés. C’est de cette période sombre et méconnue de l’histoire dont parle Isabelle Picard dans son dernier roman, Des glaçons comme du verre. En s’inspirant de faits réels, d’histoires qui lui ont été contées, et de celle de sa propre famille, l’auteure et ethnologue pose une pierre de plus à l’édifice de la réconciliation.
Des glaçons comme du verre: un roman clef !
 « Quand il croise Belle à la manufacture de raquettes où il travaille, Henri devine qu’elle sera la femme de sa vie, mais pas tout de suite. Il est Huron, elle est Beauceronne. La musique les unira en leur temps. De leur mariage naîtront cinq garçons et cinq filles », résume la 4e de couverture du nouveau roman d’Isabelle Picard, Des glaçons comme du verre. L’histoire commence bien. Mais la vie de Belle et Henri, les grands-parents (rebaptisés pour le roman) de l’auteure, va rapidement basculer au rythme de la maladie et des retraits forcés de presque tous les enfants de la famille. Comme dans d’autres familles de cette sombre période nommée la rafle des années 60.
« Quand il croise Belle à la manufacture de raquettes où il travaille, Henri devine qu’elle sera la femme de sa vie, mais pas tout de suite. Il est Huron, elle est Beauceronne. La musique les unira en leur temps. De leur mariage naîtront cinq garçons et cinq filles », résume la 4e de couverture du nouveau roman d’Isabelle Picard, Des glaçons comme du verre. L’histoire commence bien. Mais la vie de Belle et Henri, les grands-parents (rebaptisés pour le roman) de l’auteure, va rapidement basculer au rythme de la maladie et des retraits forcés de presque tous les enfants de la famille. Comme dans d’autres familles de cette sombre période nommée la rafle des années 60.
Avec Des Glaçons comme du verre, on ne peut que mieux comprendre la persévérance des communautés autochtones du Québec de ces cinq dernières années à réclamer, devant les tribunaux, le droit d’organiser et de gérer leur propre système de protection de l’enfance. Surtout lorsqu’on apprend que la rafle des années 60, qui désigne l’enlèvement de plus de 20 000 enfants autochtones, s’est faite sous couvert de la protection des enfants en contexte d’assimilation, on a juste envie de dire : ouf ! devant l’ampleur de la tragédie.
Mais depuis février 2024 : au Québec, – une demi-décennie après le reste du Canada – les Autochtones ont désormais le droit de veiller eux-mêmes au bien-être de leurs enfants.
Par ailleurs, le Québec n’a toujours pas présenté d’excuses publiques pour la rafle qu’elle cautionnée et orchestrée dans les communautés, contrairement aux provinces des Prairies qui se sont excusées auprès des survivants, en 2018 et 2019.
À qui de droit : il n’est pas trop tard !
Malgré la noirceur des événements, aussi vécus par sa famille, Isabelle Picard nous plonge dans cette rafle avec nuance et contexte, au point qu’on en arrive à se demander si les méchants en sont vraiment. Comme le croit l’auteure : « Personne n’est tout blanc ou tout noir. » À vrai dire, le doute s’immisce à plusieurs reprises. On se rappelle cependant, et assez rapidement, que même une bonne âme ne peut se faire pardonner d’arracher un enfant à sa famille sans son consentement et en toute impunité.
Et que dire des parents qui restent derrière, tourmentés, pris entre l’arbre et l’écorce, obligés de voir leurs enfants disparaître un à un, jusqu’à ce que le silence des maisonnées devienne torture, au point d’avoir besoin de noyer l’impuissance pour survivre.
Plus qu’un roman, Des glaçons comme du verre fournit la bonne paire de lunettes, celle qui permet de voir la force des politiques d’assimilation à travers le vécu de ses victimes ; de regarder autrement la réalité moderne des communautés, teintée par les traumas, la pauvreté, et les dépendances. Ce sont aussi nos propres biais allochtones qui se révèlent à chaque page tournée, et dont la prise de conscience impulse l’envie de rencontrer…
Un roman pédagogique merveilleusement ficelé, rempli de clefs de compréhension et qui, à l’instar de la série jeunesse Nish, mériterait une place sur les pupitres d’école.

L’Itinéraire s’est entretenu avec Isabelle Picard, qui, mot après mot, contribue à révéler l’histoire et à combler les vides intérieurs, dans l’espoir d’avancer sur le chemin de la guérison.
Isabelle Picard, vous êtes née en 1976, vous êtes Huronne-Wendate, de Wendake. Votre roman, lui, est campé dans les années 50, dans la même communauté, alors que votre mère n’était encore qu’une enfant. Dès les premières pages, on est étonné de constater à quel point l’acculturation était déjà très présente dans la communauté.
Oui, ça étonne souvent. Wendake, on l’appelait le village Huron à l’époque. C’était déjà urbanisé, l’économie était très axée sur le tourisme, principalement européen. Les raquettes, les canots, les boutiques d’artisanat… il y avait ce désir de plaire. J’ai donc grandi avec un gros tipi au milieu de mon village, mais les tipis sont algonquins. Nous, on est iroquoiens. Ce qui fait en sorte que j’ai grandi dans une culture qui n’était pas tout à fait la nôtre.
Vous expliquez d’ailleurs avoir vécu 13 années coupée de votre culture. Ce qui nous amène à la crise d’Oka. C’était comment l’avant et l’après-Oka ?
La crise d’Oka a réveillé tout le monde. Heureusement qu’elle est arrivée. Le lien au territoire et le savoir artisanal était encore là, mais on allait déjà à l’église, on ne savait même plus parler notre langue. La crise d’Oka a fait l’effet d’un wake-up call. Les gens se sont mobilisés, on a recommencé nos cérémonies après que les Mohawks, nos cousins, nous les aient réenseignées. Puis la langue est devenue très importante alors qu’elle était complètement éteinte. Mais il nous restait des dictionnaires et des lexiques qui avaient été écrits par les Jésuites. Et nous avions nos amis mohawks dont 90 % de la langue est similaire à la nôtre. Moi même je réapprends ma langue. Certains, comme moi, étaient très heureux de pouvoir le faire. D’autres se disaient : mais à quoi ça sert ? Est-ce qu’on ne serait pas mieux d’apprendre l’espagnol ? C’est ça l’acculturation, mais une fois que les enfants rentrent de l’école en expliquant que tel mot veut dire telle chose, ça contamine de manière positive. Aujourd’hui, des gens sont capables de tenir des conversations de base. [Isabelle Picard a participé à la réintégration de la langue à Wendake et dans l’école de la communauté en réunissant 1 M$ et en tissant des liens avec des professeurs spécialisés en langue iroquoienne, jusqu’en Californie.]
La spiritualité, la vision du monde, le lien entre la langue et le territoire, la prise de conscience a vraiment eu lieu pendant la crise d’Oka.
Vous êtes ethnologue, conférencière, chroniqueuse, écrivaine. Transmettre est votre mission de vie. Pourtant il y a quatre ans seulement que vous avez décidé d’écrire sur la rafle des années 60. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Si j’avais écrit ce livre plus tôt, les gens n’auraient eu ni les connaissances ni la sensibilité nécessaire pour l’accueillir. Il fallait attendre que les communautés soient prêtes. Mais aujourd’hui, c’est important de raconter cet épisode de vie. Je donne des formations à des gens qui viennent en aide à des personnes en situation d’itinérance, et ce qu’ils me disent, c’est que ce ne sont pas toutes des personnes qui étaient en pensionnats. Beaucoup sont passés par la rafle des années 60.
Sans divulguer la fin du roman, l’une des protagonistes de la deuxième partie lit une lettre qui lève le voile sur de nombreux non-dits. Cette lecture comble alors un vide qui l’habitait depuis toujours. Ressentiez-vous ce vide-là, petite ? Est-ce que la crise d’Oka a eu l’effet de la lettre de votre roman ?
Petite j’entendais des bribes d’informations. Mon père, victime de la rafle, nous racontait qu’il n’aimait pas le gruau, le pouding au riz… Mais sans jamais nous expliquer pourquoi. Je portais un fardeau que je ne comprenais pas. Un jour, j’ai dit à mon père que je voulais devenir pensionnaire de l’école religieuse où j’allais, les Ursulines de Québec. Ça avait l’air le fun. Le soir, les élèves étaient entre amis, ils faisaient les repas ensemble, etc. Mon père [envoyé en orphelinat et en maison de redressement pendant la rafle des années 60] ne le voulait pas, mais a accepté que j’essaye deux semaines. Quand il m’y a conduit, il a pleuré. Ça, je ne l’ai su que plus tard. Je n’y suis restée qu’une semaine. Je sentais ce poids que je ne m’expliquais pas. C’est ça les traumatismes intergénérationnels, ce sont les malaises des autres qui s’ancrent et se transmettent sans mots.
Souvent, on ne pose pas de questions, parce qu’on voit que c’est douloureux. Souvent, l’alcool délie les langues. Alors pour comprendre, j’ai commencé à questionner, et vers l’âge de 40 ans, la maturité a fait que j’étais prête. J’avais besoin de passer au travers, j’avais besoin de combler des trous, j’ai fait la paix avec mon grand-père qui pour moi avait abandonné ses enfants… Mais quand on lit le roman, on comprend la vérité.
SI j’avais dû nommer votre roman autrement, je l’aurais appelé La shed, en référence à ce cabanon tout croche que votre grand-père regarde silencieusement en se demandant comment le redresser, comme il se demandait comment redresser sa vie… D’où vient le titre de votre roman ?
Le titre m’a comme été insufflé. Mon grand-père travaillait dans le bois (à plus de 200 km de Wendake). Moi-même, j’adore le bois, et par le plus pur des hasards je me suis retrouvée là où il travaillait, au Club Triton, en allant dans un chalet. J’ai vu l’auberge, le lac principal… Ç’a été fabuleux. Et c’est en arrivant dans un chalet où je me rendais tout de suite après que j’ai trouvé le titre de mon livre avant même de l’écrire. J’ai vu des glaçons sur le bord de la fenêtre. Je les ai trouvés aussi magnifiques que fragiles.
Ce livre aurait pu être le procès d’un gouvernement, de certains protagonistes de votre livre qui ont concrètement participé aux malheurs de votre famille et de bien d’autres. Mais il n’en est rien, et c’est assez incroyable.
N’oublions pas que tout a été orchestré par le gouvernement fédéral pour qui il était facilitant de sortir les Autochtones de leurs communautés pour les assimiler. Et au milieu de tout cela, il y avait des gens qui devaient travailler, gagner leur pain. Ils étaient obligés de faire cela. Certains essayaient d’être bienveillants, d’autres étaient peut-être plus enclins au racisme. C’est donc important de montrer les nuances. Il existe d’ailleurs des témoignages de personnes qui ont vraiment vécu ces contraintes et qui ont finalement compris que les raisons qu’on leur donnait pour justifier le retrait des enfants des familles étaient fausses.
Tout de votre roman semble tellement crédible, qu’on aurait aimé des astérisques pour signaler les faits inventés. Quel pourcentage du livre est réel ?
La première fois que j’ai eu connaissance de la rafle des années 60, c’était il y a 15 ans. Une Atikamekw me racontait qu’elle était avec son frère jumeau à l’hôpital de Joliette pour une pneumonie. Ils venaient de Wemotaci. Au bout de deux semaines, son frère est sorti et elle est restée parce que sa pneumonie était plus grave. Mais quand son père est venu la chercher, elle n’était plus là. Elle avait été adoptée de force et elle me disait que sa mère n’avait jamais signé les papiers d’adoption. Elle n’est retournée dans sa communauté qu’à l’âge de 40 ans.
Des histoires comme ça qui m’ont inspirée, il y en a plein dans mon roman. La première partie est assez réelle, la seconde est plus mélangée.
Comment vous êtes-vous senti au point final du roman ?
Soulagée ! Je suis une écrivaine qui écrit vite. Mais ce roman… J’ai dû prendre des pauses. C’était difficile d’écrire l’enlèvement des enfants, alors que ce sont des gens que je connais. J’ai essayé de mettre de la lumière dans mon roman. Je craignais aussi les retours et d’ouvrir des garde-robes qu’on voulait garder fermer. Mais ce roman a été écrit de manière respectueuse, et est bien contextualisé. Je souhaite qu’il amène des discussions, aide à comprendre, et à recréer des solidarités.