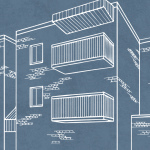« L’infodémiologie », comme l’a nommée l’Organisation mondiale de la santé, est l’un de ces néologismes apparus avec la pandémie. Ce mot illustre la surabondance d’informations, fiables ou non, observées au cours d’une épidémie. Celles qui sont fausses sont comme des agents pathogènes ; elles se propagent plus rapidement et à grande échelle, complexifiant ainsi la transmission des faits au grand public, et donc la compréhension et l’adhésion aux mesures sanitaires. D’où le besoin d’aplatir la courbe en vulgarisant les connaissances scientifiques.
Mais, ce n’est pas si simple de se retrouver dans tout ce brouhaha. Qui écouter et à qui accorder de la crédibilité ? Comment s’assurer que ce qu’on lit est avéré ? Chaque prise de parole publique, pour peu qu’elle soit faite par un journaliste scientifique ou un scientifique, est mise au banc d’essais, questionnée, voire discréditée. L’accusation de proximité avec la politique est celle qui revient le plus souvent. Face à l’organisation et la planification dont font preuve certains groupuscules spécialisés en désinformation, mieux comprendre la science n’a jamais été aussi essentiel qu’aujourd’hui.
Sous sa cape d’Infoman, Jean-René Dufort, biochimiste de formation, a ce côté dubitatif inné. Il en est certain : la pandémie a changé la donne en information scientifique. « Avant ça, on n’avait pas à prendre de décision scientifique chaque jour ou chaque semaine. La notion même de ce qu’est un média sérieux a changé depuis l’arrivée et la maîtrise des réseaux sociaux. »
Il y a 10 ans, l’animateur se souvient avoir été interviewé par une personne ingénieuse qui avait utilisé son iPhone « pour faire ça en live » sur un réseau social. Par ce geste, aujourd’hui anodin, cette personne était devenue techniquement un média. « C’était à la fois épeurant et intéressant. Cela prouvait que l’information se démocratisait, mais l’effet pervers de ça, c’est qu’elle est devenue presque une question d’opinion. Or, la science n’est pas une opinion, c’est une connaissance accumulée d’éléments vérifiés et vérifiables sur l’être humain. Que tu croies ou non en la gravité, c’est bien d’valeur, mais ton jus d’orange se versera quand même dans ton verre. »
Cette science dont on parle prend du temps à être confirmée ou infirmée par les pairs, c’est-à-dire les autres scientifiques. Et le temps est une notion qui s’est confrontée au choc de voir le monde se confiner brutalement en mars 2020. On voulait avoir des réponses immédiates pour comprendre ce qu’il était en train de se passer.
En d’autres termes, il se peut qu’on se dise qu’un élément était supposément vrai pour s’apercevoir que ce n’est peut-être plus tout à fait le cas aujourd’hui. Et les exemples ne sont pas en reste. « Je comprends que ce ne soit pas facile de s’y retrouver dans un nuage d’opinions. Ce n’est pas simple de garder confiance en la science. Si l’on dit que quelque chose est faux après avoir dit six mois plus tôt l’inverse, cela ne veut pas dire que ce n’est pas vrai. Cela signifie qu’il y a des chercheurs qui travaillent de la façon la plus rigoureuse possible pour trouver une réponse, sans qu’elle ne soit totalement définitive. Elle est là la nuance. »
En point de presse chaque semaine, on a assisté à des dialogues de sourds. Les journalistes voulaient des réponses à livrer les premiers aux lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs assaillis de toute part. Ceci alors que la science ne pouvait pas toujours en donner dans l’immédiat. « Qu’on soit clair, nous on peut se tanner, mais le virus ne se tanne pas, lui. On dit que le message passe moins, mais je crois qu’on est juste fatigués de l’entendre, comme lorsqu’on assiste à la fin d’un cours de mathématiques. Cela ne veut pas dire que le prof transmet moins de matière, cela signifie juste que l’on est moins réceptifs », ajoute Jean-René Dufort.
[…]
Un aura de truc compliqué
Rien n’a vraiment surpris Valérie Borde en termes de désinformation. La cheffe du bureau sciences et santé de L’Actualité est aussi codirectrice du centre Déclic, un organisme dont le but est de rétablir le dialogue entre les scientifiques et le public. Tisser des liens entre deux mondes qui s’ignorent et ne parlent pas la même langue, celui de la science et celui du grand public, c’est son combat. « Il y a tout un pan de la population que l’on n’arrive pas à rejoindre parce que tout le monde est dans sa bulle. C’est difficile de sortir du public habituel, mais c’est tellement nécessaire », estime-t-elle.
Quand la science s’invite dans les médias, la première des difficultés est de la contextualiser. « Oui, les résultats d’études sont rapportés, mais que veulent-ils dire réellement? Pourquoi parle-t-on d’une étude plutôt qu’une autre? Prendre chaque résultat pour une certitude, ça ne marche pas. La science a toujours eu cet aura du truc compliqué. On doit donc redoubler d’efforts, quitte à revenir à la base dans nos explications: rappeler le fonctionnement d’un vaccin ou du système immunitaire par exemple. En science, on a une barrière de confiance en soi, plusieurs personnes se disent qu’elles ne vont riencomprendre, que c’est trop complexe. »
Les scientifiques ont de la misère à communiquer avec le grand public. « Présupposer des connaissances ne mène pas à une compréhen- sion des choses. La question de la confiance est primordiale, on doit travailler à la rétablir et cela se fait aussi en dehors des réseaux sociaux où un dialogue est réellement possible. L’un en face de l’autre, ça ne dégénère pas autant, même quand on n’est pas d’accord. Il faut arriver à décortiquer les faits et ça ne se fait pas en cinq minutes derrière un écran. Il faut qu’on ait de vraies conversations. L’idée n’est pas de culpabiliser l’autre qui ne croit pas aux vaccins, on doit aussi faire preuve d’empathie, car la confiance marche des deux bords », pense la professionnelle.
Et quand certains de ses articles sont détournés de leur objectif initial pour servir d’autres desseins que celui d’informer, Valérie Borde travaille deux fois plus rigoureusement ses textes. « Il y a une différence entre ceux qui lisent un article, me disent vendue au gouvernement ou m’envoient des commentaires haineux et ceux qui font de l’argent ou qui financent ces théories sur le dos de ces personnes. En fait, c’est plus ceux-là qui me fâchent. »
Bien s’outiller
Même combat pour Ève Beaudin de l’Agence Science-Presse. Avec le Détecteur des rumeurs, la rubrique qui déboulonne les mythes scientifiques, la journaliste tente de limiter les dégâts causés par les fausses nouvelles, si possible, avant qu’elles ne se propagent trop. Un travail plus ardu en temps de pandémie où un seul et même sujet, la COVID-19, mène à toutes sortes de théories. «Le web a été submergé d’informations, mais on avait déjà nos mécanismes pour rectifier le tir. Il fallait continuer de rappeler aux lecteurs les réflexes à adopter avant de partager ou de croire à une information », explique-t-elle.
Avec la pandémie, on en a lu, vu et entendu des choses étonnantes et contradictoires en même temps. « Il y a eu des moments difficiles, car il y avait tellement de mythes à déboulonner, mais il fallait qu’on revienne à la base, qu’on fasse encore plus de textes clairs et solides où l’opinion n’a pas sa place. C’est simple de trouver une étude qui nous conforte dans nos idées et de faire bande à part, ça l’est un peu moins de comprendre la littérature scientifique et de contextualiser. On ne peut pas tout déboulonner à chaque fois qu’on soupe avec quelqu’un. Il faut aussi comprendre ce qui inquiète le monde et se rappeler que c’est parfois plus rassurant de croire en quelque chose que d’accepter une pandémie ou des mesures sanitaires restrictives. On a tous nos mécanismes de protection, mais l’important est de remettre les choses en perspective. » Et tout cela passe, selon Ève Beaudin, par la production d’outils et l’éducation aux médias qui arment le monde à avoir les bons réflexes avant de partager une nouvelle.