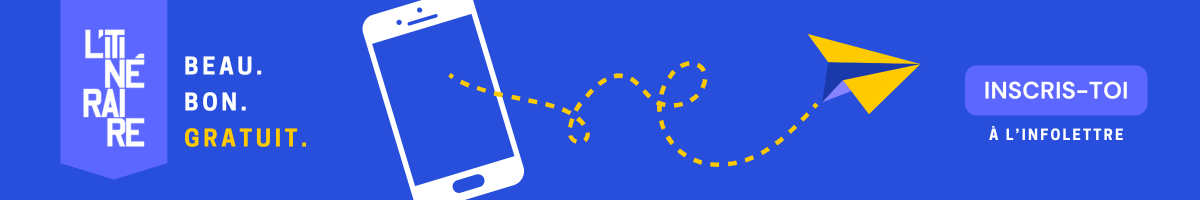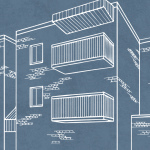En 2018, la Nation Atikamekw officialise sa propre DPJ : le Système d’intervention d’autorité Atikamekw (SIAA) ; du côté de Sept-Îles, les Innus d’Uashat mak Maliotenam sont en voie de voter leur propre loi sur la bienveillance et la protection de l’enfance. En 2019, le Canada a affirmé les droits et la compétence des peuples autochtones en matière de services à l’enfance et à la famille à travers le projet de Loi C-92. « Les choses avancent dans la bonne direction », affirme André Lebon, ancien psychoéducateur jeunesse et vice-président de la Commission Laurent.
Mais pour certains, la marche est plus haute. Comme pour le peuple inuit du Nunavik dont les enjeux chroniques – manque de logement, accès à l’eau potable, consommation, éducation, entre autres –, font barrage à l’autodétermination de cette communauté. Des défis qui, en bout de ligne, retentissent sur la sécurité et l’épanouissement des enfants retirés de leurs parents par la DPJ. C’est ce qu’a vécu Amanda*, déplacée près de 30 fois par la DPJ et aujourd’hui accueillie dans la famille d’accueil de Virginie*. Mère et fille racontent.
_____________
* Noms fictifs
Arrivée dans son nouveau chez elle, Émilia s’est approchée d’un arbre et a enlevé sa mitaine. De sa petite main d’enfant à peine âgée de plus de 4 ans, elle a ramassé une branche au sol qu’elle a porté à son visage pour en sentir les bourgeons. La jeune Inuk n’a pas tout de suite compris ce que c’était…
Au Nunavik, l’horizon est dénué d’arbres ; le climat arctique y est rude, comme les conditions de vie du peuple inuit. C’est dans cette région du Québec à plus de 1400 km de leur nouvelle maison que sont nées Émilia et sa sœur Amanda.
Après avoir été déplacée une trentaine de fois depuis sa plus tendre enfance, de familles d’accueil en centres jeunesse, de Montréal à Puvirnituq (l’un des 14 villages du Nunavik), Amanda n’a posé ses valises que tout récemment chez Virginie où elle se sent enfin chez elle et apaisée. « J’ai des blessures à guérir, mais je me sens beaucoup mieux qu’avant », partage-t-elle, en entrevue avec L’Itinéraire.
Le périple d’Amanda depuis sa prise en charge par la DPJ n’est pas sans rappeler celui de Maggie Kimattuuti Padlayat, une jeune Inuk du système, morte par suicide à 18 ans.
 Photo : courtoisie
Photo : courtoisie
Après la colère
Amanda ne changerait rien de son vécu, même pas le décès de ses parents. « Avant, j’avais de la peine, j’étais en colère », explique-t-elle. Aujourd’hui, elle est déterminée à guérir et préfère accepter autant le bon que le mauvais.
Et du positif, en parlant des souvenirs qu’elle conserve de sa petite enfance dans sa communauté, elle en a : « Je me souviens de la chasse au phoque, de la viande crue que je mangeais : béluga, caribou, poisson ; on faisait beaucoup de camping aussi… »
« Ce sont tous de bons moments », dit-elle, soulignant avec lucidité qu’il y en a aussi eu des mauvais. Son retour dans sa communauté en est un, après plusieurs années d’absence passées dans des milieux complètement détachés de la culture inuite. « Je me faisais intimider parce que je ne savais pas parler ma langue, l’inuktitut, raconte-t-elle. À l’école, je ne pouvais même pas sortir à la récréation, parce que je me serais fait tabasser. Ils prenaient ma tuque, ils pissaient dedans et me la lançaient. Aussi, j’avais de la misère à partager ; je suis passée de fille unique à une famille de six enfants. »
Amanda restera quatre ans au Nunavik, accueillie provisoirement dans différents lieux des services de protection, avant de repartir vers Montréal. « J’ai eu quand même un TS [ travailleur social ] chez qui je suis restée et avec qui j’ai gardé des liens. Il travaillait depuis 10 ans dans le Nord », relate Amanda.
Permettre aux enfants d’être des enfants

« Il manque de familles d’accueil là-bas, enchaîne Virginie, qu’Amanda considère comme sa mère. Un enfant peut alors être placé chez une infirmière ou un travailleur social » provisoirement. Et pour avoir vécu au Nunavik, Virginie sait de quoi il en retourne.
« La nuit, ce n’est pas rare de voir des petits enfants dans la rue, parce qu’ils y sont plus en sécurité que dans leur maison avec leurs parents intoxiqués », décrit la mère. Ces mêmes parents qui ne nient en rien leur problème de consommation, précise-t-elle. « Ils savent qu’ils ont un problème et ils le disent. Mais c’est tellement ancré depuis les pensionnats qu’ils ne savent plus comment s’en sortir. Les gens des pensionnats boivent pour panser leur douleur, les enfants les voient boire et boivent à leur tour… jusqu’à ce que quelqu’un brise le cercle. »
Autant de circonstances qui ont poussé son mari et elle à devenir famille d’accueil. « J’ai toujours voulu m’impliquer auprès des enfants. Et être là, passer du temps avec eux, c’est pas rien pour eux. Parce que quand t’es là, ils se sentent en sécurité, et peuvent être des enfants. »
Le Nunavik, ma maison!
En parlant des Inuit, Virginie martèle : « Je les aime tellement d’amour ! » Même si ce n’est pas tout le temps facile de vivre au Nunavik, confirme-t-elle. « Il n’y a pas assez de logements, pas d’eau courante, l’internet est à chier et, quand ta tank à eau est vide, plus rien ne marche ; chaque deux ou trois jours, un camion doit passer pour remplir la citerne d’eau potable, et un autre pour vider la marde… C’est comme faire du camping à longueur d’année. Y-a-t-il quelqu’un en 2024 qui accepterait de vivre comme ça ? »
Virginie est revenue vivre dans sa région d’origine quelques années après avoir pris sous son aile la petite Émilia, qui lui a été confiée par la DPJ, à la demande de sa maman biologique. – « La meilleure des mamans quand elle était sobre » –, souligne-t-elle régulièrement à Émilia lorsqu’elles parlent de
son histoire et d’où elle vient.
Quand on lui demande pourquoi elle a quitté le Nunavik, un silence s’impose…
Virginie répète à quel point elle porte la communauté inuite dans son cœur, mais évoque une forme de fatigue. « Tout ce qui est choquant pour les Blancs devient normal au Nunavik : roter à table comme parler du dernier qui s’est suicidé. Ta normalité change. J’ai enterré trop de jeunes avec qui je travaillais. Certains font plus mal que d’autres et je ne compte plus le nombre de fois où j’en ai vu un rentrer au travail avec la trace de la corde autour du cou. Tu le sais… un jour, il ne rentrera pas travailler. Face à ça, on se sent impuissant parce que même si tu veux être là pour l’individu, il y a la barrière de la culture et
de la langue, celle de la peur des préjugés et la honte de la personne. »
Mais quand je vais au Nunavik, « c’est comme rentrer à la maison », auprès d’un peuple qui lui a beaucoup apporté, notamment des valeurs auxquelles elle a connecté : « Quand t’arrives là-bas, comme Blanc tu te dis : » Ça n’a pas de sens, ce n’est pas de même que ça marche « . Mais qui a dit que ce n’était pas correct d’aller chasser l’outarde pour nourrir sa famille ? Qui a dit qu’avoir des enfants qui courent partout dans une église n’est pas correct non plus ? Que de les élever comme ils le font, en communauté, est moins bien que notre façon ? »
Les jeunes, la solution
Virginie déplore que l’on ne voie pas tout ce que l’on pourrait apprendre du peuple inuit, et des Autochtones en général : le respect de la nature, la résilience, la spiritualité partagée, l’esprit de communauté. Alors c’est important de garder le lien avec le Nunavik et sa communauté. En faisant souvent le trajet avec ses filles jusque là-bas, elle espère les aider à conserver le lien avec leur culture et à en être fières.
« Les elders [ aînés ] le disent. Ça prendra encore deux générations au moins avant un retour à la normale », et la jeunesse semble faire partie de la solution. « Je discute beaucoup avec Amanda de ce qu’elle aimerait améliorer dans sa communauté. On voit de plus en plus de jeunes qui reviennent au Nunavik après avoir fait leurs études. »
Et ces jeunes savent ce que vivent leurs parents.
Entre lenteur administrative et isolement
Pour devenir autonomes en matière de protection de la jeunesse, les Inuit du Nunavik doivent prouver leur capacité organisationnelle. Une mission qui va «prendre un bon 20 ans encore», estime M. Lebon qui les accompagne depuis 1997 dans cette démarche. Il faut dire que les défis sont de taille et maintiennent la population dans une précarité dont les nombreux enjeux ralentissent la création d’une vision à long terme.
Accès à l’éducation, à l’eau potable, manque de logement, etc., sont les enjeux en question. Mais surtout, il y a l’isolement géographique, sur lequel insiste André Lebon, et qui fait que «tout prend un temps démesuré». Il donne l’exemple d’un plan pour la réadaptation des jeunes sur le territoire qui a pris un an à être accepté par le gouvernement du Québec et pour lequel «les projets de construction n’auront pas lieu avant sept ans» faute d’être sur «le dessus de la pile» des priorités gouvernementales.
Ajouter à cela qu’une poignée de bateaux seulement assurent le ravitaillement vers le Nunavik chaque été: «Si t’as pas déjà commandé tes matériaux pour ton école illustre l’ancien psychoéducateur, t’es fait!».
Nunavimmi Ilagiit Papatauvinga: La «DPJ inuit»
Depuis près de 20 ans qu’il soutient l’organisation des services sociaux du Nunavik, M. Lebon voit bien que les choses n’avancent qu’à tout petits pas. Mais «depuis 2017, la communauté s’oriente vers une organisation de services 100% inuit qui, à terme de sa maturité, chapeauterait ceux offerts aux familles et aux enfants. Ça s’appelle Nunavimmi Ilagiit Papatauvinga, ce qui signifie les services qui protègent les enfants et la famille.»
On peut affirmer que le choix pour l’avenir d’assumer leur propre service est fait. La population s’est exprimée sur les services pertinents à mettre en place, le cœur d’une équipe est également formé. Seulement pas un Inuk ne travaille encore à l’avancement de ce projet. En cause, l’éducation: «Les Inuit ont un grand retard scolaire, explique M. Lebon, parce qu’il manque de personnel, certaines classes peuvent fermer un an de temps.» Résultat des courses, «on compte sur les doigts d’une main les gens qui sont diplômés du secondaire et ceux qui ont un niveau cégep.»
Ce qui fait qu’aujourd’hui encore et contrairement à d’autres nations comme leurs voisins Cris, «98% des intervenants qui travaillent au Nunavik sont allochtones parce que les Inuit qui voudraient travailler comme intervenants ne sont pas qualifiés.»
Seulement, ils ne connaissent pas le territoire, les défis des communautés et encore moins la langue.

De la colère envers le système
Le manque d’Inuit dans les services sociaux, particulièrement en intervention, crée «un véritable enjeu de collaboration avec la DPJ qui a d’ailleurs très mauvaise presse», constate M. Lebon. Il n’en a pas toujours été ainsi.
Il y a eu des périodes plus «glorieuses» que d’autres, comme dans les années 2010, alors que chaque intervenant de la DPJ était jumelé à un Inuk. «Quand tu arrives dans une famille en crise, c’est plus facile d’intervenir dans la langue de l’individu», illustre le spécialiste. Aujourd’hui, la plupart des jeunes de moins de 15 ans sont trilingues (Inuktitut, anglais et français), mais leurs parents sont pour beaucoup unilingues et nourris par une forte colère liée aux traumatismes collectifs.
Est-ce qu’un siècle de pensionnat, la rafle des années 60, jouent encore sur les perceptions qu’ont les Inuit de la DPJ? «Totalement!», répond sans hésiter M. Lebon. «On les a retirés de la vie nomade en les regroupant dans des villages; quand dans les années 60 le gouvernement s’est aperçu qu’ils préféraient retourner dans la toundra avec leurs chiens, ils ont massacré les chiens. La rancœur est forte chez les 40 ans et plus.» Pour bon nombre de communautés autochtones, la DPJ est perçue comme la continuité des pensionnats et autres actions d’assimilation; un pavé sur le chemin de la réconciliation.
Les femmes, les jeunes, les traditions
Dans toutes les communautés autochtones, la notion de elders en est une sacrée. Et tout en conservant ce respect envers eux, André Lebon observe une levée de la jeunesse. «J’ai vu des jeunes dire à des personnes âgées: “malgré tout le respect que l’on vous doit, oui, les massacres de chiens, les collèges et les drames, mais ça suffit les réminiscences, tournons-nous vers l’avenir.”»
Une nouveauté qui semble être là pour rester et qui donne à son observateur l’espoir d’un changement. Tout comme la présence des femmes, de plus en plus impliquées en politique ou dans des postes de gestionnaires. «Elles ne l’ont pas facile, constate-t-il, mais j’ai espoir une fois de plus qu’elles prennent
de la place parce que leurs actions sont très significatives.»
Une lenteur utile
La collégialité des décisions et l’adhésion de la collectivité avant de passer à l’action sont des aspects clefs de la gouvernance autochtone. Et il s’accompagne de la lenteur. Il en va de même pour développer le Nunavimmi Ilagiit Papatauvinga, le système inuit de protection de la jeunesse. Sans cette lenteur utile, le travail de mobilisation et d’adhésion n’est pas fait et accroît le risque d’échec. «Si les communautés vont trop vite, ma crainte est que les gouvernements disent des Inuit qu’ils sont incapables de gérer leur propre système, ce qui lui donnerait une raison de plus pour se substituer.»
Une forme de paternalisme dont la communauté Atikamekw s’est officiellement débarrassée en 2018 par l’officialisation de son Système d’intervention d’autorité atikamekw (SIAA), sa DPJ.
L’Inspiration Atikamekw
Quand la Loi C-92 qui affirme l’autodétermination autochtone en matière de protection de la jeunesse a été sanctionnée, la Nation Atikamekw fêtait la première année officielle de son Système d’intervention d’autorité atikamekw (SIAA) sur lequel la DPJ québécoise n’a aucun droit de regard, comme le précisent en entrevue la directrice à la protection sociale atikamekw, Alice Cleary, et son adjointe Guylaine Saganash.
C’était comment, la prise en charge de la protection des enfants et des jeunes avant le SIAA?
On travaille avec les centres jeunesse depuis 1985 et nous avons toujours dénoncé le fait que la Loi sur la protection de la jeunesse a été mise en place sans que l’on soit consulté. Il y avait aussi beaucoup plus de signalements et les interventions se faisaient en français, langue que les familles ne comprenaient pas. Puis, on perdait nos enfants, placés à l’extérieur de la communauté. La Loi ne tenait pas compte de notre réalité, et heurtait surtout notre conception de la famille dont la mobilisation est importante pour l’intérêt de l’enfant.
Comment s’applique concrètement la protection des enfants atikamekws aujourd’hui?
Un enfant est une responsabilité collective. Quand il naît, il arrive dans une maison où vivent parfois deux ou trois familles, par manque de logements. C’est très différent du modèle québécois. On appelle ça de l’attachement multiple.
Lorsqu’on a un changement de milieu pour un enfant, on demande d’abord à la famille qui est la meilleure personne pour prendre soin de lui, le temps de prendre une décision. Il faut que la famille fasse partie de la solution et du processus. Oui, on s’assure que l’enfant est en sécurité, mais rien n’est fait à la hâte. Puis on croit en l’individu. Celui qui traverse un moment difficile ne restera pas toujours de même.
Le SIAA compte trois instances : le conseil de famille, le conseil des sages, le cercle d’aidants. On demande alors aux parents qui ils verraient dans le cercle de famille. Puis qui peut les aider. Ces aidants feront partie de l’intervention. Ils vont se mettre d’accord avec les parents sur l’aide qu’ils pourront apporter.
Et en 2018, vous avez transféré au SIAA tous les dossiers des jeunes atikamekws pris en charge par la DPJ.
Ça s’est fait en plusieurs étapes, par la signature de l’article 37.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse, du Québec et après 20 ans de travail et le dépôt de plusieurs rapports sur le pourquoi la LPJ n’est pas applicable. La majorité des dossiers était des placements en famille jusqu’à 18 ans. On a regardé chacun des dossiers, et, quand la situation le permettait, on a autant que possible ramené les jeunes dans leur famille. D’autres avaient complètement perdu leur identité atikamekw. Il ne voulait rien savoir. Ils étaient en conflit identitaire.
Votre organisation suffit-elle pour répondre à tous les besoins de protection?
Non, nous n’avons pas tous les services, mais nous travaillons sur des investissements. Par exemple, on n’a pas de centre de réadaptation. On a donc besoin de nos partenaires, notamment pour tout ce qui
touche la justice pénale et les ressources en pédiatrie sociale.
Vous venez de lire un extrait de l’édition du 15 octobre 2024. Pour lire l’édition intégrale, procurez-vous le numéro de L’Itinéraire auprès de votre camelot ou abonnez-vous au magazine numérique.