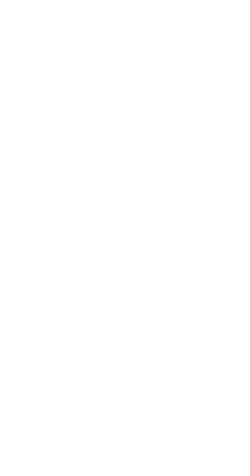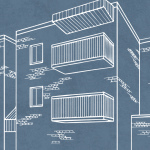Une famille, un juge. C’est l’objectif du projet de loi 91 instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec déposé par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette. Il s’inscrit dans une série de réformes visant à traiter les questions familiales devant un seul et même tribunal. Le dépôt de ce projet de loi a poussé L’Itinéraire à réfléchir au concept de coparentalité de manière plus large ; d’abord juridique, mais également sociologique et psychologique. Des expertes nous ont aidés dans nos réflexions.
Fini de courir d’une Cour à l’autre
D’emblée, le droit familial est complexe et ratisse large. Vous êtes en procédure pour un dossier de violence conjugale ? Vous ferez entendre votre cause à la Chambre criminelle et pénale. À la suite d’une séparation, la résolution des versements de la pension alimentaire n’aboutit pas ? Vous n’arrivez pas à vous entendre avec votre partenaire pour la garde des enfants ? C’est la Cour supérieure du Québec qui vous entendra. Pour vos demandes relatives à leur sécurité ou pour un signalement à la DPJ ? Votre dossier sera confié à la Chambre de la jeunesse. Un véritable « parcours labyrinthique », comme le disait lui-même le ministre Simon Jolin-Barrette lors de l’annonce, en février dernier, de la création du Tribunal unifié de la famille, prévu dans le projet de loi 91. Ce dernier s’inscrit dans la philosophie du droit familial du gouvernement caquiste selon le principe « une famille, un juge ». Au terme des réformes, un couple avec enfant pourrait faire entendre l’ensemble des questions familiales devant un seul et même tribunal. Un couple avec enfant aurait également l’obligation de participer à un processus de médiation lorsqu’il y a séparation. Il pourrait en être exempté dans certaines situations, comme dans les cas de violence conjugale.
Un vaste chantier
Le projet de loi 91 fait suite au projet de loi 2 adopté en partie en juin 2022, au projet de loi 12 adopté en juin 2023 et au projet de loi 56 adopté en juin 2024. Les projets de loi 2 et 12 ont apporté des changements notables sur la filiation, incluant des modifications terminologiques afin de tenir compte des nouvelles réalités parentales (par exemple, l’homoparentalité). Ils visaient également à encadrer légalement les recours impliquant une grossesse pour autrui (mère porteuse). De plus, un enfant né d’un viol a maintenant des recours juridiques pour rompre son lien de filiation avec le parent-agresseur. Enfin, le projet de loi 56 visait la création d’un nouveau régime d’union parentale, soit un statut juridique donnant les mêmes droits familiaux aux conjoints de fait ayant un enfant qu’aux parents mariés ou unis civilement. Au Québec, 43 % des couples vivent en union libre. Par ces réformes préalables, le projet de loi 91 n’aurait ou n’aurait pas tenu compte des nouvelles réalités parentales.
Vous venez de lire un article de l’édition du 1er avril 2025.