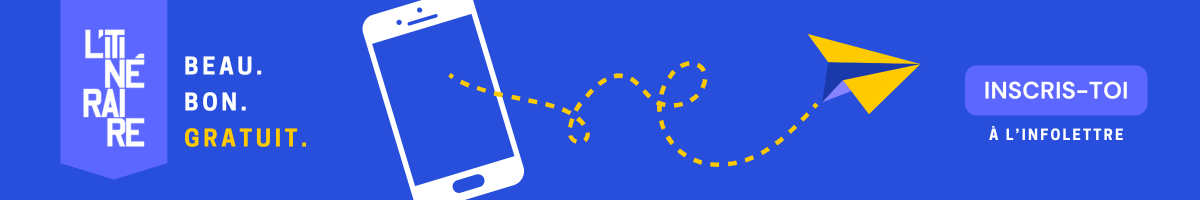Alex et Jess* quêtent ensemble au métro Radisson depuis près d’un an. Ils dorment dans un abribus et se mettent au chaud quand ils le peuvent. Les deux acolytes se sont rencontrés dans la rue et, de fil en aiguille, sont devenus amis puis amants.
Ce couple, c’est à travers un soutien mutuel qu’il prend forme : Alex a toujours eu de la misère à se gérer. Il est souvent pris avec des crises de colère que Jess sait calmer. Elle sait s’y prendre. Et au-delà des urgences du quotidien : manger, dormir au chaud, s’habiller, se protéger… Alex et Jess ne manquent pas de libido. Une sphère de la vie de couple des gens de la rue largement oubliée, écartée, invisibilisée.
Des couloirs universitaires à ceux des hébergements d’urgence, L’Itinéraire a couru les témoignages ; ceux des intervenants, des itinérants, des scientifiques, puis des politiques pour comprendre la santé sexuelle des personnes en situation d’itinérance au-delà des risques liés aux infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), VIH, grossesses non désirées ou encore aux violences sexuelles.
Quand on demande à Jess et Alex comment ils se débrouillent pour se donner de l’affection, eh bien, c’est exactement ce qu’ils répondent : « On se débrouille ! »
* Prénoms fictifs
Encadrer l’intimité
 Photo : Gabriel Lavoie
Photo : Gabriel Lavoie
Des couples qui vivent dans la rue, il y en a de plus en plus. Mais les refuges d’urgence, en plus de ne pas avoir été pensés pour eux, ont peu de places qui leur sont réservées, témoignent les intervenants rencontrés dans plusieurs refuges mixtes gérés par le CAP St-Barnabé et Mission Old Brewery.
En marchant dans l’ancien aréna du YMCA d’Hochelaga-Maisonneuve, transformé temporairement – depuis quatre ans – en refuge d’urgence, il n’est pas surprenant d’entendre un chat en laisse miauler ou de flatter un gros chien qui veut jouer. La ressource gérée par le CAP St-Barnabé, organisme d’aide aux personnes en situation d’itinérance, accueille dans ce lieu 200 personnes, en plus de gérer deux autres refuges à proximité. Au total, environ 350 personnes « résident » dans leurs trois refuges. Sont acceptés : les chats, les chiens… et les couples. Service rare quand on comprend qu’à Montréal, il y a 18 lits réservés aux couples, dont 16 dans Hochelaga-Maisonneuve et deux au refuge de l’Hôtel-Dieu.
Revenons au chien. C’est l’animal de Pierre et Nicole qui occupent un des neuf cubicules réservés aux couples au refuge Hochelaga (l’un des trois refuges gérés par le CAP St-Barnabé). C’est un peu la raison pour laquelle ils ont perdu leur logement et se sont retrouvés, pour la première fois, dans la rue en octobre dernier. Tous trois partagent l’espace aménagé de deux lits superposés et d’une table. Difficile de vivre leur intimité quand on constate l’action qu’il y a dans les couloirs entre les cubicules séparés par des bâches et des deux-par-quatre.
Préjugés
Philippe-Benoit Côté, chercheur porteur du champ itinérance au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales (CREMIS) et professeur en sexologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) est l’un parmi les rares de son domaine d’expertise à s’intéresser à la question. Selon lui, la sexualité et l’intimité des personnes en situation d’itinérance représentent « une goutte d’eau dans l’océan de la littérature scientifique sur l’itinérance ».
« Inexistante », « pas reconnue », « associée au risque », la sexualité des personnes en marge est souvent vue par la lorgnette des ITSS et celle de la sécurité physique des personnes, notamment des abus sexuels, du travail du sexe et des violences conjugales.
Sans contredit, ces obstacles légitiment l’encadrement des pratiques sexuelles des couples en hébergement d’urgence, mais comme le fait comprendre M. Côté : au risque de se noyer dans une flaque d’eau, on s’empêche d’y sauter. Autrement dit : il serait intéressant de penser la sexualité des personnes en situation d’itinérance autrement.
L’amour sans adresse
« On a de plus en plus de personnes en première situation d’itinérance, et on a de plus en plus de couples pour qui la rue, c’est nouveau. Moi si j’arrive dans un refuge pour la première fois, avec mon chum, sépare-moi pas ! », explique Catherine Lesage, coordonnatrice clinique pour le CAP St-Barnabé.
Un couple qui se présente au refuge Hochelaga n’aura pas à subir d’interrogatoire pour déterminer si l’en est un vrai ou pas. Les « faux » couples, c’est assez facile de les repérer parce qu’ils se forment souvent sur place et le font uniquement pour avoir un cubicule plus rapidement, faute de place individuelle, explique-t-elle.
En se promenant plus loin dans l’aréna, on comprend l’impatience des 25 personnes seules assises sur des chaises en permanence, en attente d’une place horizontale. « On a une personne qui dort depuis un mois sur une chaise parce que le refuge est plein, explique Jayson Martin, aussi coordonnateur du refuge. Si un couple se forme sur place, parce que ça arrive, on va attendre une période de trois semaines avant de les intégrer en cubicule, s’il y a de la place. »
Le refuge de l’Hôtel-Dieu
C’est la même réalité au refuge de l’Hôtel-Dieu géré par Mission Old Brewery, une ressource avec deux chambres réservées aux couples. Seule nuance importante : les chambres sont fermées, ce qui demande plus de vigilance. « Souvent, on connaît les couples de la rue, lance Émilie Fortier, directrice des services d’urgence du refuge. On intervient quand on a des doutes, et si on constate de la violence dans la dynamique des deux personnes ou du travail du sexe, on ne tolérera pas ça dans nos installations. On n’est pas équipé pour faire une thérapie de couple non plus. »
Loin de porter des lunettes roses, Émilie Fortier est réaliste. Une personne qui vit dans la rue a nécessairement une histoire difficile et des enjeux psychosociaux. Les relations interpersonnelles peuvent être autant d’obstacles et de raisons pour les- quels on n’encadre pas plus ce besoin d’intimité et de sexualité dans les refuges.
« Derrière ça, par contre, j’ai vu de très belles histoires d’amour de rue. Oui, il peut y avoir de la consommation ensemble et des enjeux de codépendance, juge l’intervenante, et nous devons intégrer ces défis d’intervention de couple en itinérance dans nos approches. »
Abstinence
Hervey et sa femme Lynda sont abstinents depuis qu’ils ont mis les pieds au refuge Hochelaga. Après une discussion franche, le couple a pris la décision de mettre cette sphère de leur vie de côté, « le temps de trouver un logement », comme le dit Hervey, rencontré seul. L’important, pour eux, c’est d’être ensemble. Impensable de laisser sa femme dans un autre refuge, explique-t-il. « Elle a ses difficultés en lien avec des épisodes de rue passés, le stress, la sécurité… »
La routine pour le couple est simple : faire de la recherche d’emploi, de logement, manger et dormir. Hervey reste positif : « À par que c’est plate et qu’il ne se passe rien de ce côté-là avec ma femme, on se fait des câlins, on se prend dans nos bras, on s’encourage, on
se dit que c’est temporaire. » Eux aussi, à l’instar de Pierre et Nicole, font « lit » à part. Le modeste matelas double est petit pour deux personnes. « Ça me manque de dormir collé et tranquille, juste ça, même pas sexuel, mais juste ça, c’est quelque chose. »
Catherine Lesage juge important de permettre aux couples de dormir ensemble, « ce n’est pas juste la sexualité, mais un contact intime avec l’autre », qui peut être essentiel pour un minimum de stabilité – et même être un levier – dans ces situations limites.

Le sexe, un besoin essentiel ?
Tout comme Émilie Fortier, le professeur en sexologie Philippe-Benoit Côté marche sur des œufs quand on lui demande si la sexualité est un besoin physique essentiel de base. « C’est plus complexe que ça, avance-t-il. Je pense que c’est plus un outil qui peut répondre à plusieurs autres besoins. »
Émilie Fortier n’est pas certaine de savoir où situer la sexualité parmi les besoins primaires des êtres humains. « Est-ce qu’on peut vraiment mettre l’éjaculation, l’orgasme, dans les besoins physiques de base, au même titre que de se protéger, se nourrir, se laver ? C’est une bonne question et je n’ai pas la réponse. »
Une équipe imparfaite
Depuis que Pierre et Nicole ont mis les pieds au refuge Hochelaga, Pierre dort chaque nuit tout habillé, avec son manteau d’hiver, parce qu’il veut être prêt si une urgence survient. Il accompagne aussi Nicole quand elle se rend aux toilettes et aux douches, à sa demande. Ensemble, ils forment une « équipe de survie ». Pierre ramène un peu d’argent ; il fait de petits travaux ici et là. Pour Nicole, c’est une protection et un revenu pour le couple. Quant à elle, elle gère les affaires du couple, fait de la recherche de logement et surtout, soutient son conjoint émotionnellement, lui qui cumule crises de panique et pleurs depuis qu’il réside dans l’ancien aréna du YMCA.
Émilie Fortier est témoin des dynamiques relationnelles complexes qui viennent teinter la relation amoureuse des couples qu’elle croise sur l’étage qui leur est réservé. « C’est toujours chargé d’enjeux psychosociaux, estime-t-elle, et il faut avouer que certains couples sont ensemble pour des raisons d’utilité, de survie, de travail d’équipe. »
Pour des raisons de protection, les femmes vont davantage mobiliser cette instrumentalisation que les hommes, avance Philippe-Benoit Côté, pour qui, en effet, la rue introduit une réalité aux « conditions complexes, remplie de barrières, d’enjeux personnels, d’étiquettes et de stigmatisation. »
(Un peu) surveiller et (ne pas) punir
La lumière s’éteint à 21 h chaque soir dans l’aréna du CAP St-Barnabé. Quand le lieu devient moins animé et que tout le monde est en poste pour passer à travers une autre nuit, il reste rare pour les intervenants de constater des actes sexuels comme la masturbation, le visionnement de pornographie ou encore des couples qui vivent leur sexualité comme ils le peuvent. Mais ça arrive. Et quand ça se passe, « si c’est subtil, si ça ne dérange pas les autres dans les cubicules, on laisse aller », dit le coordonnateur Jayson Martin. Sa collègue Catherine Lesage est du même avis : il y a tolérance dans la limite du respect des autres et de l’espace.

À l’Hôtel-Dieu, les couples en chambres fermées « sont des adultes », dit Émilie Fortier. Elle et son équipe sont tolérants sur les actes sexuels dans la mesure où ils ne sont pas faits en chambre partagée ou dans les espaces publics. Par contre, en dehors de la tolérance, et excluant l’approche de prévention des violences et des hépatites, du VIH et d’ITSS, aucun service n’est officiellement mis en place pour accompagner les personnes en situation d’itinérance dans leur sexualité en général, de couple en particulier, au sein des deux refuges.
Cocher une case couple (inexistante)
Il ne fait aucun doute pour le professeur Côté que loger des couples est difficile, faute d’avoir une case à cocher « couple » quand on se cherche un logement social. C’est ce que déplore Émilie Fortier. Pour elle, c’est le gros problème : « Les vrais couples, ceux pour qui ce n’est pas uniquement une relation utilitaire et sexuelle, ne chercheront pas à se stabiliser dans une ressource d’urgence. Leur besoin, c’est le logement, mais faute d’en avoir un, ils se stabilisent dans la rue. »
L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) offre des petits studios pour personnes seules. Pour les ménages, bonne chance. Vous serez en attente avec les 24 000 autres demandes sur la liste. Il faut ajouter à cet obstacle la Loi sur l’aide sociale qui émet un chèque selon la logique « d’une adresse, un chèque », et qui encourage les couples à vivre à deux adresses différentes pour ne pas perdre de revenus.
Les angles morts
Émilie Fortier est catégorique : il faut repenser les espaces dans les refuges. Il y a de plus en plus de personnes âgées en situation d’itinérance présentant des défis de mobilité dans de vieux bâtiments souvent peu adaptés pour les accueillir. Elle remarque aussi qu’il y a de plus en plus de couples, et c’est une question de temps avant de voir apparaître des familles entières aux portes des refuges en lien avec l’arrivée de demandeurs d’asile au Québec.
La question qu’elle se pose, pour les couples, c’est comment mettre en place des espaces dédiés aux relations intimes et sexuelles sans provoquer de maltraitance dans les ressources. Il y a des risques et des angles morts, juge-t-elle. « Demain matin, tu me donnes un nouveau bâtiment pour faire de l’urgence, je comprends le besoin d’intimité et tout, mais je me demande juste comment le faire, et ça fait 10 ans que je suis sur le terrain. »
Philippe-Benoit Côté et Catherine Lesage sont du même avis. Revoir les espaces pour reconnaître et agir sur cette sphère dans les approches d’intervention requiert l’ajout de professionnels pour éviter de précariser encore davantage les personnes en situation d’itinérance, notamment les femmes.
Mériter son plaisir…
Outre le financement d’enjeux de santé publique : prévention des ITSS, prostitution, etc., la question de la sexualité des personnes qui habitent la rue ne trouve guère de résonance (positive) dans la sphère politique. Quant à la perception de la population (qui dispose d’un toit) elle peut cacher un certain nombre de préjugés. L’un d’eux : le mérite. « Parce qu’elles n’occupent pas d’emploi rémunéré, [ les personnes en situation d’itinérance ] ne mériteraient ni une alimentation saine ni un logement décent, et encore moins l’accès à des moments de plaisir. Car il faut travailler et payer des impôts pour mériter ce que l’on a », peut-on lire dans le rapport Photovoix : Le plaisir, un besoin essentiel pour touTEs, publié en 2019 par le Carrefour de savoirs sur la lutte aux préjugés du Collectif pour un Québec sans pauvreté.
En résumé, disons que le petit couple dans la vingtaine qui se galoche intensément à l’ombre d’une ruelle est à priori plus légitime que le couple d’itinérants qui en fait autant.
…Ou s’abstenir ?
Si on suit cette logique, le sexe et l’argent sont liés. Et Il faut donc avoir les moyens de se payer un loyer pour pouvoir s’épanouir sexuellement. Mais quand le budget ne le permet pas, et hormis les quelques chambres en hébergements d’urgence ouverts aux couples, on fait comment pour partager de l’affection ?
« Les personnes vont utiliser les toilettes publiques, se cacher derrière des buissons, se mettre entre deux arbres… », décrit le professeur Côté. Émilie Fortier de Mission Old Brewery, complète : « Dans ce type de dynamique et de précarité, c’est la chambre d’hôtel en début de mois et la ruelle après. Ça fait partie des patterns », et ça ne prend pas longtemps dans ces circonstances pou que le montant de l’aide sociale s’évapore, souligne l’intervenante.
Un mur de tissu
À demi-mot, on ose évoquer la pertinence des campements comme de possibles lieux d’intimité. Une solution provisoire certes, mais qui offre au moins l’option d’être caché derrière un mur de tissu de tente. « Ça me fait de la peine de l’admettre, mais oui », dit la directrice du refuge de l’Hôtel-Dieu, c’est actuellement une solution très adaptée, au regard de l’insuffisance de l’offre de service.
Tout le monde n’est cependant pas de cet avis. Si Hervey et sa blonde du CAP St-Barnabé n’ont jamais fréquenté de campements, pour lui, ce n’est pas une option et encore moins pour sa blonde, affirme-t-il : « On veut un logement avec une porte qui se barre. » Une réticence qui se comprend, notamment de la part des femmes souvent plus vulnérables en contexte d’itinérance où le sexisme y est par ailleurs très présent, précise Philippe-Benoit Côté pour parler de la dynamique du milieu.

Plus sécuritaire qu’il n’y paraît
Sur la question de la sexualité des couples d’itinérants dans les campements, et à défaut d’avoir obtenu un retour constructif du CISSS de l’Outaouais « sans information à ce sujet » (comme d’autres organes politiques sollicités), nous avons demandé à notre collègue journaliste Jules Couturier qui se rendait justement au campement du site Guertin, à Gatineau (territoire du CISSS de l’Outaouais) de prendre le pouls. Contre toute attente, deux personnes interviewées, dont les partenaires étaient absents au moment de la rencontre, rapportent un sentiment de sécurité et une tranquillité d’esprit acceptable à « vivre le campement » en amoureux. Rappelons toutefois que ce dernier est orchestré par l’organisme Itinérance Zéro qui veille au grain et au bon déroulement de la saison hivernale pour les occupants des 48 tentes.
Une initiative intéressante pour des villes où les refuges débordent.
En entrevue dirigée avec plusieurs personnes en situation d’itinérance, Philippe-Benoit Côté l’a lui aussi constaté : « Les tentes sont de bonnes alternatives. Les couples ne préfèrent de toute façon pas aller dans des refuges pour ne pas être séparés. »
Un discours qui revient souvent selon l’expert, même si pour certains, être séparés est aussi l’occasion de prendre une pause de l’autre, relate Émilie Fortier qui rappelle que les couples en itinérance, ce n’est pas toujours du bonbon.
Une «fucking house » bruxelloise
Sur l’un des murs d’une sorte de gazebo en bois, rebaptisé Love Room et reconverti en nid douillet pour amoureux sans domicile fixe (SDF), se trouve un imposant panneau blanc sur lequel est inscrit : All you need is love. En 2017, en Belgique, l’organisme bruxellois Corvia a créé dans le fond de son jardin la Love Room. Un espace intime, accessible gratuitement sur réservation, pour les couples itinérants le temps d’un tête à tête ; comme on loue un chalet pour un week-end en amoureux (ou passe un 72 h au deux mois dans un « studio » carcéral dédié aux visites familiales privées de certains détenus).
Nous ne savons pas si la Love Room existe encore, faute d’avoir pu joindre une personne de l’organisation, mais l’un des témoignages rapportés par la chaîne de télévision française France 3 était sans équivoque : « Moi, j’ai 32 ans, dit un jeune homme assis sur le lit dans le gazebo, ma copine a 30 ans. Tout est toujours dur dehors, et quand on vient ici… Après il faut retourner dehors et ça, on n’en a plus envie. » Les sociologues appellent ça l’effet de cliquet, celui de ne plus vouloir revenir en arrière une fois que l’on a goûté à un certain niveau de confort, à un mode de vie, ou simplement à un toit quand on est itinérant.
Par ailleurs, c’est à une sans-abri que revient le crédit de la Love room. « J’en ai marre de montrer mon cul dans la rue, Mathilde. Fais quelque chose ! Fais une fucking house ! ». Mathilde, c’est Mme Pelsers, la responsable de Corvia en 2017, à qui s’est adressée cette femme, désespérée du manque d’intimité, toujours selon France 3.
Volonté politique insuffisante
Les politiques publiques pourraient « inclure la santé sexuelle positive dans d’autres priorités », affirme Philippe-Benoit Côté. Mais sur le terrain, la sexualité des personnes en situation d’itinérance est largement invisibilisée. Tous les interlocuteurs contactés en conviennent. Et l’information se vérifie d’un simple « CTRL+F ».
« Intimité », « sexualité », « affection », « plaisir », « relations sexuelles », « droit à la sexualité » aucun de ces mots-clés ne se trouve dans les plans d’action en itinérance, autrement qu’intégrés au terme « violences sexuelles » ou liés aux ITSS. Et ce, tant au palier municipal (Plan concerté montréalais en itinérance 2021-2026 : S’unir dans l’action) qu’au provincial (Plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026, S’allier devant l’itinérance).
Pourtant, tout le monde l’affirme (off the record seulement et non sans rires nerveux) : il est normal de jouir d’une bonne santé sexuelle, de vouloir et d’entretenir des rapports intimes.
Rappelons que la santé sexuelle est, aussi : la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui reconnaît entre autres cet aspect des rapports humains comme un droit.
Et pour que ce droit puisse s’exercer, certaines conditions doivent être réunies, dont celle de vivre dans « un environnement qui affirme et promeut la santé sexuelle ».
Les grands oubliés
Dans le programme Travail du sexe coordonné par Joris Grail, les intervenant.e.s abordent le travail du sexe sous différents angles : autonomisation, moyens de protection, prévention des risques dont la violence, « pas mal plus présentes dans les relations intimes des personnes itinérantes » qui représente la moitié des usager.e.s du programme.
Mais bon nombre de questions ne se posent pas, souvent freinées par l’étiquette criminelle apposée sur le front des travailleur.euse.s du sexe. C’est ainsi que les intervenant.e.s eux-mêmes apprennent par hasard certaines informations qui concernent leurs usager.e.s. Comme les lieux de pratiques des activités sexuelles. Parmi eux, certains saunas gais, comme l’était le GI Joe, rue Sainte-Catherine, dans le Village. « On a su que certains usager.e.s. fréquentaient le GI Joe en discutant avec de l’incendie de l’établissement, par hasard. »
Autrement, les intervenants n’avaient connaissance que des lieux habituels de travail du sexe : voitures, ruelles, ou encore parcs publics dont le plus connu du Village, des travailleurs de rue et du poste 22 : le « Parc des putes » ou Parc Charles-S.-Campbell de son nom officiel.
Sauna, 6m2, un lit et un bureau
C’est aussi à la mpox (variole simienne) que l’on doit un partenariat et une présence renforcés de RÉZO dans les trois saunas gais de Montréal, à des fins de prévention et de santé sexuelle globale. Là-bas, les hommes à la recherche d’un partenaire, ou d’un client ont à leur disposition tout le matériel sexuel sécuritaire nécessaire.
C’est justement la sécurité des lieux qui semblent interpeller le plus certains clients des saunas, comme Jean-Jeanette qui les fréquente depuis 30 ans. « Moi je suis travesti, et au sauna, il y a une grande tolérance envers moi. La violence n’est pas acceptée dans ces lieux.
Et quand il y en a, le personnel sacre la personne dehors. Je me sens en sécurité au sauna. »
Jean-Jeannette se rend là-bas avant tout pour cruiser, et plus si affinités. Et sans ces lieux « ouverts et informels », elle affirme qu’elle se serait prostituée. Pourquoi ? Pour pouvoir dormir au chaud : « Nulle part ailleurs les pauvres peuvent se payer une chambre pour dormir au chaud et avoir des relations sexuelles et aussi à cause de sa dépendance au sexe : « Je suis accro », confie-t-elle.
Et lorsqu’on lui demande la différence entre le sauna et une maison close, elle dit clairement : « Y’en a pas ». « C’est comme un bordel », mais qui, pour Jean-Jeannette, répondait à l’époque à ses droits les plus élémentaires : dormir au chaud, dans un endroit propre, avec une porte qui se verrouille, socialiser et avoir le temps d’exercer une sexualité sans risque.
Vous venez de lire un extrait de l’édition du 15 février 2024. Pour lire l’édition intégrale, procurez-vous le numéro de L’Itinéraire auprès de votre camelot ou abonnez-vous au magazine numérique.