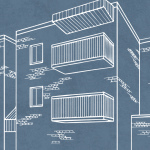Seules dans leur voiture, elles sillonnent les rangs de campagne en s’arrêtant de ferme en ferme. Elles partent chaque matin à la rencontre des producteurs agricoles sur leur chemin. Leur mission? Repérer la détresse, offrir du soutien psychosocial et briser l’isolement d’un mode de vie sans répit et exigeant. À l’image des travailleurs de rue, ce sont des travailleuses de rang. L’Itinéraire s’est entretenu avec Martine Fraser, l’une d’entre elles, qui parcourt chaque jour l’arrière-pays en solitaire. Regard sur cette profession encore jeune et méconnue.
Travailleuses, puisqu’elles sont 19 femmes parmi les 23 travailleurs de rang de la province. Martine Fraser, travailleuse sociale de formation, provient comme la plupart de ses collègues, du milieu agricole. À l’instar des travailleurs de rue, elle intervient directement dans les fermes de la Mauricie pour offrir du soutien, de l’écoute et des solutions aux difficultés que vivent les agriculteurs et leurs familles.
De l’aide qui n’est pas de trop, selon l’Association québécosie de prévention du suicide (AQPS) et de l’Union des producteurs agricoles (UPA), dont les chiffres révèlent que la moitié des producteurs agricoles de la province vivent une détresse psychologique élevée et le taux de suicide dépasse largement la moyenne québécoise.
Run de lait
Lorsqu’on l’a jointe au téléphone, Martine Fraser était en train de revoir les tâches de sa journée. Ce jour-là, il faisait beau, et les fermiers qu’elle devait visiter travaillaient aux champs. Comme c’est la température qui dicte les priorités, elle ira donc se promener, en pleine campagne pour voir si elle ne rencontrerait pas des agriculteurs à l’improviste sur son passage.
« Je tourne à droite, je tourne à gauche, je vais là où la route me mène, dit-elle. Je laisse des dépliants dans les boîtes aux lettres. Quand j’ai la chance de voir un agriculteur travailler dehors, je prends le temps de m’arrêter et de jaser un peu.» S’ils n’ont pas toujours le temps de s’arrêter, elle donne un coup de main à la tâche et discute en même temps, même si elle martèle le message «qu’il est important de prendre une pause pour parler de ce que l’on vit ».
Elle s’attelle également à créer tout un réseau de «sentinelles» autour des fermes afin que les signes de détresse détectés lui soient rapportés. Sur son chemin, elle rencontrera peut-être un concessionnaire de machinerie, un mécanicien, un vétérinaire ou encore un vendeur agricole, à qui elle pourra expliquer son rôle et donner ses coordonnées. « Je veux avoir des yeux et des oreilles partout. Je ne sais pas nécessairement elle est où la ferme dans X ou Y rang, je ne passerai peut-être jamais par là. Mais le vétérinaire qui s’y rend, lui il le sait, et il peut prendre le pouls quand il rencontre l’agriculteur et sa famille », dit celle qui a également une ferme laitière avec son conjoint et son père.
Parler le même langage
S’il n’est pas nécessaire de provenir du milieu agricole, Martine Fraser avoue que ça l’aide beaucoup dans son travail. Elle parle le même langage, ce qui facilite le lien de confiance, croit-elle. Un langage qui peut avoir des termes spécifiques propres au métier. Mais pour elle, cette langue agricole est avant tout un outil d’intervention pour percer une carapace qui est encore épaisse, n’en déplaise aux préjugés : les agriculteurs ont plus de difficulté à parler et à reconnaître leurs signes de détresse. Pour délier les nœuds de l’orgueil et du «je suis capable tout seul», Martine Fraser est rendue experte en «métaphores agricoles».
« Je leur dis souvent: “C’est sûr que c’est tough de parler de ses émotions, mais on brasse la marde au printemps et à l’automne pour que le sol soit fertile. Ce n’est pas plaisant de jouer dans les émotions, comme dans le fumier, mais après il y a quelque chose de fertile qui pousse. On voit ce qu’on récolte ”, explique-t-elle. Je peux aussi dire: “On ne roule pas longtemps avec un moteur pas d’essence. Alimente ton moteur, mets du bon gaz et roule plus loin”.» Cette réalité agricole difficile, remplie de stress et d’impondérables, elle la connaît bien.
Elle s’inquiète d’ailleurs qu’on perde une ferme par jour au pays, selon les dernières données de Statistique Canada. Un chiffre qu’elle trouve «éloquent» surtout quand elle fait de la sensibilisation grand public sur ce métier vocationnel.
Ce que l’on contrôle (ou pas)
L’agriculture apporte son lot d’imprévus avec lequel les producteurs doivent composer. Météo, accidents, conjonctures économiques, tendances alimentaires, besoins animaliers, maladie dans le troupeau, pertes dans la production, des réalités qui mettent à l’épreuve la résilience de ces travailleurs essentiels.
Et le dénominateur commun dans tout ça? L’argent. Car même si elle intervient auprès d’agriculteurs qui vivent de l’anxiété, des problèmes conjugaux et de l’épuisement, la question financière teinte toujours le portrait. « Beaucoup n’ont pas de marge de manœuvre. Un agriculteur qui a des défis et du stress financiers, ça va avoir un impact sur la famille, le couple », dit Mme Fraser.
Si la crise inflationniste actuelle met de la pression sur les agriculteurs, de manière générale, le prix des terres ne cesse d’augmenter au Canada depuis 40 ans. Une terre qui valait 1000$ l’hectare en 1985 se vend aujourd’hui 16500$ l’hectare, selon Financement agricole Canada.
« Ce n’est pas très invitant pour les jeunes de se lancer en agriculture quand on s’endette de quelques millions de dollars en partant, dit la travailleuse de rang et productrice laitière. Tu dois en vendre en maudit des pommes pis des carottes à deux piastres pour rentabiliser la terre, alors quand un imprévu arrive, c’est la catastrophe. On ne peut pas blâmer les consommateurs, ils vont vers le moins cher qui n’est pas toujours local. Tout le monde pense à son portefeuille. »
Des vacances ?
Joëlle Gagnon est propriétaire de la ferme maraîchère Le Jardin des Défricheurs, à Ferland-et-Boilleau au Saguenay. Cette année, c’est la première fois en 17 ans qu’elle prend une semaine pour elle en pleine saison. « Je mets le frein parce que je n’ai pas le choix, comme bien des producteurs autour de moi. Chaque début de saison, je vis du stress et du découragement. Là je dois ralentir et prendre congé, je constaterai l’état des lieux à mon retour ». Elle reconnaît que les travailleuses de rang sont essentielles pour répondre aux nombreux besoins en soutien psychosocial et dans son réseau de producteurs.
Chaque matin entre six et huit heures, elle est dans son bureau à «régler de la paperasse». Elle sort ensuite travailler dans ses champs. Elle va désherber, arroser les semis, s’occuper de la serre, faire les travaux d’aménagement du terrain et entretenir les bâtiments. Les travaux de base du quotidien. « Mais il arrive toujours un pépin, quelque chose qui a cassé ou quelque chose qui ne se passe pas comme tu le pensais, relate-t-elle. C’est aussi beaucoup d’heures pour peu de revenus. »
Pour Joëlle Gagnon, le printemps apporte un haut niveau de stress, en plein début de saison, où les investissements sont énormes et les imprévus parfois fatals. « Quand il arrive un gel, c’est la panique. Je sors le soir avec ma lampe frontale pour couvrir mes plants de tomates parce que j’ai peur de tout perdre », dit la propriétaire du jardin maraîcher. Cette année, ses semis n’ont pas germé en raison du temps plus frais au Saguenay. C’est dans ce contexte qu’elle laisse la ferme aux mains d’un employé embauché ad hoc le temps de s’envoler pour les vieux pays, et plus précisément dans les Alpes pour participer à un concours de sculpture sur paille et foin !