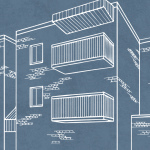Entre chien et loup, la nuit prend sa place et réveille sur son passage la vie nocturne et ses convives. Sous les fenêtres endormies, marginaux, artistes, fêtards et travailleurs en tout genre s’affairent dans cet écosystème.
La réputation du nightlife de Montréal semble s’éloigner de plus en plus des réalités. Pour Mathieu Grondin, fondateur de l’organisation citoyenne MTL 24 / 24, il est temps de mettre les bouchées doubles pour réviser les règles qui régissent la vie nocturne, et ouvrir le dialogue à d’autres enjeux.
Le DJ l’affirme, ce n’est pas juste une histoire de partys, c’est aussi « du développement communautaire, artistique, culturel, ç’a un lien avec la santé publique, la sécurité urbaine… ». Des facettes que Montréal a le pouvoir d’encadrer depuis qu’elle est reconnue comme métropole et qu’elle peut déroger à certaines lois provinciales pour gérer les activités de son territoire, selon ses spécificités. Notamment en matière d’itinérance, de culture, de patrimoine et d’habitation. Des enjeux qui ne dorment jamais et auxquels L’Itinéraire s’est intéressé.
À l’instar des grandes métropoles du monde ou les nuits blanches sont histoires du quotidien, Mathieu Grondin rêve d’un Montréal ouvert 24 h sur 24 h. Une ville où la nuit n’est que la continuité du jour, avec sa propre politique qui répond aux besoins des noctambules qu’ils soient travailleurs de nuit, fêtards ou itinérants.
Pour l’artiste nocturne, il est temps de redynamiser le milieu de la nuit par un système de gouvernance dédié, plutôt que de la réprimer, et d’honorer le statut de métropole culturelle de Montréal. À commencer par l’art et ses adeptes.
À la même poutine
À New York, Berlin, Paris, Amsterdam… les activités de nuit se décomplexent. Pour certaines, depuis plus d’une décennie. « New York a créé l’Office of Nightlife et à Berlin, les commerces et salles de spectacle sont ouverts 24 h sur 24 », énumère M. Grondin. Même « Toronto a l’équivalent d’un maire de la nuit. Ils se sont intéressés à la vie nocturne avant nous », dit celui qui raconte que dans sa jeunesse, « tout le monde riait de cette ville, parce que les bars fermaient à 1h du matin. Mais aujourd’hui, ils ont de plus en plus de dérogations pour ouvrir jusqu’à 4 h ». Une situation qui semble faire frémir les noctambules québécois de longue date en concurrence depuis toujours avec ceux de la Ville Reine.
À Montréal, rien n’a vraiment changé depuis les années 70. Les bars et bars-spectacles sont encore obligés de crier last call à 3 h du matin et de fermer les terrasses vers 23 h (hors pandémie bien sûr). Pourtant, depuis 2017, Montréal est en droit d’étendre les horaires d’ouverture et de vente d’alcool, grâce à son statut de métropole.
Résultat des courses, « Les gens sont arrivés à minuit et n’ont plus que quelques heures pour profiter. Alors, pour avoir un p’tit feeling, ils se dépêchent de boire. Et quand tout est au maximum de sa capacité, on ferme les lieux. Les gens sont tous dehors, mais une demi-heure plus tôt, il n’y avait presque personne. Le monde est en état d’ébriété et certains groupes qui voudraient peut-être ne jamais se croiser dans la vie, se ramassent tous à la même poutine. C’est là que les problèmes commencent. »
Renforcer les perceptions
Par expérience, l’oiseau de nuit pense qu’étendre les heures d’ouverture des commerces, des salles de spectacles et des bars à Montréal permettrait d’éviter ces situations de nuisances qui entraînent entre autres des plaintes de bruits, cheval de bataille de la cohabitation entre noctambules et résidents.
« C’est une problématique que l’on constate particulièrement en Amérique du Nord, là où il y a des couvre-feux », précise le fondateur. À Berlin, je n’ai jamais vu personne se battre ou vomir parce qu’ il était saoul », se souvient-il de cette ville où tout est ouvert 24 h / 24. Ici, on boit un shooter cul sec, tandis qu’à Berlin, « on le boit par petites gorgées, pour pouvoir apprécier, sans être saoul, un DJ qui joue à 7h du matin».
Ces problèmes de bruits liés aux comportements plus qu’aux diffuseurs de spectacles qui en pâtissent — le feu Divan Orange en est un exemple — renforcent une vision négative de la nuit, selon Jess Reia, professeur.e de données de l’Université de Virginie et membre du Conseil de la nuit de Montréal, une table de concertation créée par MTL 24 / 24, « La vie nocturne ressemble davantage à un écosystème, avec des communautés, des rythmes et des services différentes. Nous pouvons penser aux hôpitaux, au transport en commun, au déneigement, à la gestion des déchets, aux activités culturelles et éducatives… la liste est longue. Mais la nuit est surtout vue comme un moment de fête, de bruit, de conflit ou même d’insécurité », résume l’expert.e.
Se penser en sécurité
La sécurité est un sujet central quand on parle de vie nocturne. « On l’a compris pendant la pandémie, dit Mathieu Grondin. Les gens ne se sentaient pas en sécurité dans la rue parce qu’il n’y avait rien ni personne. Ce n’est qu’une perception, mais elle n’est pas négligeable. »
Une perception qui varie selon qui l’on est, précise Jess Reia. « La nuit urbaine fait peur différemment selon votre ethnie, votre classe, votre situation de logement, votre orientation sexuelle, votre identité et votre expression de genre ».
Ainsi pour les deux membres de MTL 24 / 24, « une rue vide peut sembler dangereuse, alors avoir des lieux ouverts jusqu’à plus tard, ou même pendant 24 heures peut garder les rues plus fréquentées et donc augmenter le sentiment de sécurité ».
Aménager l’espace urbain
Michèle Chappaz s’accorde sur ce dernier point. Bien qu’elle insiste sur le fait que ce n’est qu’un sentiment et non une assurance. La directrice générale du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM) pose alors la question : « Combien de femmes se sont fait agresser dans des lieux publics sans que personne ne bouge ? »
Féministe engagée dans différentes instances pour la sécurité des femmes en milieu urbain et professeure d’autodéfense, Michèle Chappaz juge que « la peur est déjà de l’insécurité. Elle ajoute que « la sécurité des femmes est une affaire d’aménagement urbain », en plus de dépendre de l’expérience de chacune. Elle se souvient encore du jour de la coupe Stanley, alors qu’elle remontait le boulevard Saint-Laurent : « Il y avait de la lumière, des gens. Et d’un coup, un flot d’humains est arrivé vers moi. Montréal avait gagné, les gens étaient heureux, mais moi, je me sentais vraiment en danger. »
La nuit des itinérantes
La nuit abrite aussi bon nombre d’itinérantes dont on ne connaît que trop peu de choses si ce n’est qu’elles cherchent à tout prix à ne pas dormir dehors. « On n’a pas beaucoup d’études sur les femmes en situation d’itinérance cachée, explique la directrice du MMFIM. On ne sait pas où elles dorment. Certaines vont sûrement chez des parents dans des contextes difficiles, d’autres vont chez des hommes en échange de toutes sortes de services. On suppose que c’est pour éviter de se faire agresser dans la rue. Mais c’est de l’extrapolation. »
L’itinérance est « un angle mort », dit Mathieu Grondin, qu’il semble d’ailleurs « crucial » aux yeux de Jess Reia d’aborder et de mieux comprendre pour « leur rendre la nuit moins hostile. Ce que nous voyons souvent, c’est une criminalisation de la pauvreté et de la vulnérabilité dans certaines politiques qui traitent de la nuit, des espaces publics et des services publics », déplore-t-iel.
Selon les résultats du premier dénombrement de personnes en situation d’itinérance de 2018, les quelques répondants en itinérance cachée dormaient pour 61% d’entre eux chez quelqu’un, pour 6 %, dans un motel et pour 33 % d’entre eux, en maison de chambre.
Le prochain dénombrement se tiendra le 11 octobre prochain.