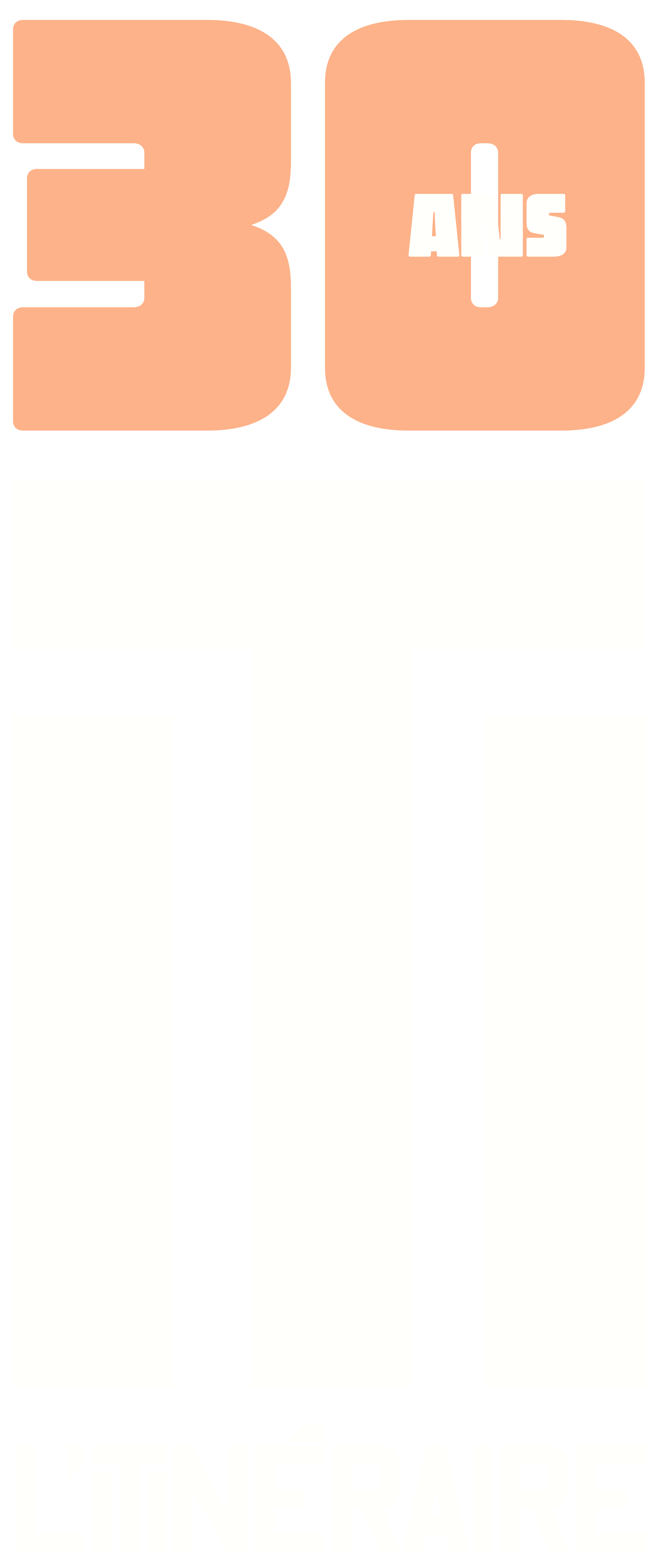Les malheureux événements qui ont bouleversé les communautés afrodescendantes ces dernières années ont également éveillé les consciences. Au Québec, c’est surtout la mort de George Floyd au printemps 2020 qui a ravivé, à grande échelle, le débat sur les inégalités sociales qui touchent de plein fouet les communautés noires. Depuis, on évoque le profilage racial, le racisme systémique… Même si tous ne s’accordent pas. Mais les inégalités sociales perdurent et les difficultés qu’éprouve le milieu du cinéma afrodescendant à percer les petits et grands écrans en sont une conséquence directe.
C’est ce que constate le réalisateur montréalais Henri Pardo, dont le documentaire Dear Jackie sur la communauté noire du quartier montréalais de la Petite-Bourgogne a été primé aux dernières RIDM (Rencontres internationales du documentaire de Montréal). Amoureux et fier de ses racines haïtiennes, Henri Pardo est surtout profondément impliqué dans le changement de regard posé sur le cinéma afrocentrique et ceux qui le font.
Dans une entrevue-fleuve, celui qui travaille en parallèle de son métier à établir le dialogue et des ententes entre ses collectifs de cinéastes afrodescendants et les hautes sphères de diffusion du Québec, partage sa vision des blocages et du chemin à parcourir pour la reconnaissance d’un cinéma identitaire.
Quel est le point de départ de votre parcours dans le cinéma ?
On est en 1981. Le mur de Berlin est encore là, c’est la fin de la guerre froide et comme gamins, on était habitué d’entendre: guerre nucléaire et éradication de l’humanité. Moi, j’étais en 6e année. Une dame recrutait à l’école de jeunes garçons pour participer à la création d’une pièce sur la paix. On a intégré la troupe de théâtre avec quelques amis. Elle était composée d’artistes de créations collectives qui nous permettaient d’écrire nos chansons, d’être sur scène et d’apprendre la mise en scène. Elle était là pour changer le monde. C’était un beau cadeau à donner aux enfants, la possibilité de réécrire le monde. Ça m’est toujours resté dans le cœur, que l’art peut servir quelque chose de grand.
Je suppose que votre parcours dans le 7e art en tant qu’afrodescendant n’a pas dû être toujours facile.
Ma période d’études au conservatoire a été assez difficile en termes d’exigence et de façon de travailler… à la dure. On casse, on moule ces jeunes adultes tout en jouant des pièces comme Othello. J’ai dû réapprendre à aimer jouer en sortant de cette formation. Et ce n’est que des années après que j’ai constaté que ma culture n’était pas incluse dans tout ça. Ce sentiment m’a poursuivi tout au long de ma carrière. Les seuls moments où je me sentais enraciné, c’était quand je jouais dans des projets plus proches de moi, qui me ressemblent.
Est-ce pour ça que vous vous êtes orienté vers un cinéma afrocentrique ?
J’ai eu des rôles importants, en anglais, en français. J’ai fait ce qu’un acteur québécois fait. À un moment donné, j’ai eu le désir
de raconter mes propres histoires. Je me suis rappelé sur le tard que j’étais allé au conservatoire pour être metteur en scène, pour diriger des comédiens. Mais je me suis laissé enrôler à la sortie: agent, contrats… Alors je me suis lancé dans un petit projet personnel, celui de jouer avec des frères. J’ai donc appelé Didier Lucien et Frédéric Pierre (tous deux acteurs d’origine haïtienne) pour leur proposer mon projet.
Notre point commun, c’est qu’on était des comédiens afrodescendants qui ne jouaient jamais ensemble des frères, des oncles, des personnages avec des liens familiaux. Alors c’était formidable. Avec ce premier pilote, j’allais me promener chez les diffuseurs pour proposer un show où les quatre personnages principaux étaient des gars afrodescendants dans la trentaine qui dealent avec leurs vies.
Comment ce projet a t-il été reçu par les maisons de production ?
On a tout entendu : les personnages ne sont pas réalistes parce qu’ils ne sont pas dans le milieu des gangs, de la dope. Pourtant, ils avaient tous des problèmes. L’un était accusé de viol, l’autre avait des problèmes de consommation depuis le décès de sa femme, l’autre encore dealait avec quelqu’un de malade et le dernier avait été abusé dans sa jeunesse. Mais les diffuseurs semblaient trouver que ce n’était pas assez réaliste pour des personnages noirs. C’était une histoire de perception. Puis ils pensaient que le public n’était pas prêt à voir un show avec seulement des personnages noirs au premier plan et qu’il ne serait pas fan de culture afrodescendante. Ma réplique à ça était: « qui ne connaît pas Michael Jackson, Prince, Beyoncé ou encore Dany Laferrière, qui est lu tout le temps ? » Et quand on demandait : « c’est quoi le problème ? » la réponse était : le silence.
Plusieurs jeunes cinéastes afrodescendants ont eu accès au programme de mentorat Encre Noire, porté par
Black Wealth Media
, une plateforme de diffusion-production que vous avez fondée. La situation est donc plus facile pour ces jeunes qu’elle ne l’était pour ceux de votre génération ?
Oui, la génération derrière nous voit les bienfaits de notre travail, même si elle ne sait pas toujours les discussions et négociations que nous avons eues avec les hautes sphères dirigeantes des diffuseurs comme Radio- Canada. Il y a aussi des événements malheureux qui ont déclenché des réflexions auprès de ces décideurs qui ne voulaient pas être du mauvais côté de l’histoire: les polémiques autour de SLAV ou la mort de George Floyd, par exemple.
Vous parlez de discussions dans les hautes sphères des diffuseurs, qu’est-ce qui a été abordé avec eux et à quel moment ont été engagé ces échanges ?
Tous les Mois de l’histoire des Noirs, il y a une grande volonté de faire des panels pour parler de la diversité à l’écran. Un jour, collectivement, on a décidé de refuser ces panels-là, parce que c’était du blabla. On en parlait, on en parlait, mais il n’y avait aucune construction ou proposition pour pallier l’absence des afrodescendants à l’écran et dans les sphères dirigeantes. On a donc amorcé des rencontres assez extraordinaires entre les dirigeants de Radio-Canada et notre collectif, qui était représenté par l’association Black on Black Films, pour dire: « Ça a beau être le Mois de l’histoire des Noirs, nous, on est là 365 jours par année et on veut laisser une marque derrière nous ».
Évidemment, le blocage est toujours le même: l’argent. Et il en faut pour faire une différence. Mais le portefeuille disponible, lui, ne bougeait pas. C’était un point difficile. On a donc proposé de regarder premièrement ce qui se passait ailleurs. Un anthropologue culturel, James Oscar, travaillait avec nous et avait recherché du côté de l’Angleterre les efforts d’inclusion de la diversité qui avait été faits par le groupe Channel Four (chaîne de télévision publique britannique) et quel genre de vague de cinéastes ça avait provoqué. On parle de cinéastes comme Steve McQueen, dont le cinéma est exceptionnel, qui a proposé et réalisé Twelve Years a Slave en 2013 ou encore Small Axe (minisérie sortie en 2020 et dédiée à George Floyd et à tous les Noirs tués à travers le monde pour ce qu’ils étaient). Cette étude a permis de démontrer qu’on est des collègues rentables qui amènent un nouveau public, une nouvelle dramaturgie. –
Ça, c’était deux ans avant SLAV.